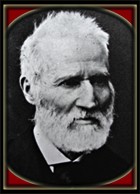| Porte | ENTREE | AnarkaiA | Point of view | Index Commune | Mise
à jour : 24/12/2007 |
 |
 |
 |
|
Visages
et figures de la Commune
Dans cette section, nous évoquerons quelques grandes figures de la Commune. Il y'en eut tellement, sans compter tout les anonymes qui donnèrent leur coeur et leur vie, pour ce magnifique projet, que cette liste n'est, bien sûr, pas exhaustive. Les Femmes
seront traitées dans la partie : Ces
grandes Femmes qui ont
fait
l'histoire Louise Michel / Femmes de la Commune La principale source de documentation de ces portraits est l'ouvrage : Dictionnaire
de la Commune
(Bernard Noël / Fernand Hazan Editeur 1971)
Militant révolutionnaire, intègre, infatigable, républicain puis socialiste, Blanqui sera de toutes les conspirations, insurrections, émeutes et révoltes qui vont parcourir le siècle, quand il ne sera pas en prison. Il y passera, près de 37 ans de sa vie, ce qui lui vaudra le surnom de l'enfermé. Il collaborera, aussi, à de nombreuses sociétés secrètes complotant contre les régimes successifs. Dés l'age de 17 ans, alors qu'il est étudiant à Paris, il entre dans l'action politique. En 1824, il adhère à la Charbonnerie, société secrète visant la destitution des Bourbons au pouvoir. Il est blessé en 1827, lors de manifestations étudiantes. En 1829, il rentre au Globe, journal d'opposition au régime de Charles X. Dans le même temps, Il étudie le Socialisme de Saint Simon. En juillet 1830, lors des 3 glorieuses, il est sur les barricades. Par la suite, il organise des cercles républicains et entre dans la Société des amis du peuple. S'ensuit une condamnanation d'un an de prison en 1832, dûe en partie à une plaidoirie qu'il fait lors de son procès, dans laquelle il se déclare prolétaire et fustige le régime. Une fois libre, il s'initie à la pensée de Baboeuf, dirige la Société des familles, avec un dénommé Barbès et entre dans la clandestinité. A nouveau condamné, puis amnistié, il refonde, avec Barbès, un nouveau groupe clandestin, la Société des saisons. En 1839, les 2 hommes tentent de fomenter une insurrection, qui échoue. Barbès est arrêté, Blanqui, réussit à fuir. En 1841, il est arrêté, à son tour et condamné à mort, mais sa peine est commuée en détention perpétuelle. Malade, jugé incurable, il est gracié, mais refuse la faveur royale. En mars et avril 1848, il organise des manifestations, réunissant 100 000 ouvriers, pour ajourner les élections à venir, afin que le peuple ait le temps de s'instruire avant de se prononcer. Accusé d'être responsable d'une émeute le 15 mai, il est condamné à 10 ans de prison. Libéré, il reprend la lutte. Il est à nouveau arrêté en 1861 et prend 4 ans de prison. Son influence grandit et un parti s'organise autour de son nom. Il s'évade en 1865 et rejoint la Belgique où un ami l'héberge. Il va vivre des moments paisibles, en profitant pour écrire sur la philosophie, l'économie et le socialisme, textes, regroupés dans 2 volumes posthumes, Critique sociale. En 1867-68, il rédige une Instruction pour une prise d'arme, traité de guérilla urbaine et programme de transition, pour aller vers une société communiste. En 1870, il revient sur Paris, à l'appel des Blanquistes, qui préparent une insurrection contre l'Empire. En vue de ce projet, il participe à une tentative de prise d'armes dans une caserne, qui échoue. Blanqui dénonce la capitulation du gouvernement provisoire, dans la guerre contre la Prusse, notamment à travers un journal qu'il lance, La Patrie en danger. Il participe aux journées insurrectionnelles du 31 octobre 1870 et du 22 janvier 1871. Le 17 mars, Thiers, le fait arrêter, en prévision des évènements qui s'annoncent sur Paris. En prison, il ne sera pas au courant de la Commune qui se met en place dès le lendemain. Libéré en 1879, il militera pour l'amnistie des insurgés, participant à réunions et banquets dans toute la France. En 1880, il fonde un nouveau journal, Ni Dieu ni Maître. A son enterrement, 100 000 personnes suivent ses obsèques. Blanquisme
Les écrits de Blanqui et ce que l'on sait de lui va former une doctrine. Des milliers de militants vont s'en inspirer et elle va jouer un rôle considérable durant la commune. Marx dira de lui, qu'il était la tête et le coeur du parti prolétaire en France. Dépassant Saint Simon et Fourrier, Blanqui fonde sa pensée sur le matérialisme, passant du socialisme utopique au socialisme scientifique et à l'athéisme le plus absolu. Celle-ci comporte, une théorie de la révolution, de la société et de la dictature révolutionnaire. La révolution est une force créatrice qui tire son dynamisme de la négation opposée à l'ordre existant et qui par la violence, transmue la société en détruisant l'oppression exercée par les privilégiés en lui substituant l'égalité et l'association de tout les Hommes. La révolution a pour but de faire entrer l'Humanité dans la phase de sa maturité qui est le communisme au terme d'un processus historique inéluctable. « L'humanité a commencé dans l'individualisme absolu et, à travers une longue série de perfectionnements, elle doit aboutir à la communauté. » Il voit l'histoire comme le développement d'un organisme animé par une spontanéité créatrice. L'humanité dispose de 2 richesses : l'intelligence et le travail et elle en combine les efforts pour agir sur le sol, élément passif. La propriété du sol devrait être à tous. Elle le fut, mais la division du travail a suscité l'échange, lequel a suscité la monnaie d'où est sorti le capital, qui par ruse et violence a capté la propriété du sol, des instruments de travail, de l'intelligence et par conséquent de ses produits. La révolution doit être menée par les déclassés, à savoir, une minorité issue de la Bourgeoisie qui a suffisamment d'intelligence et de coeur pour saisir le sens de l'évolution et rompre avec sa classe. Passés au prolétariat, ils précipitent sa fermentation et prennent la tête de son combat formant la conjuration qui organise la masse. Autrement celle-ci est vouée à disperser sa force dans une révolte incohérente. La révolution faite, cette conjuration établit la dictature révolutionnaire qui va gouverner durant la période transitoire qui mènera au communisme. Celle-ci, sorte de gendarme défendant les pauvres contre les riches s'occupera essentiellement de l'éducation du peuple car « Le communisme ne peut se réaliser que par le triomphe absolu des lumières ». Enfin, l'essentiel de son travail théorique, consiste plus à élaborer les conditions du triomphe de la révolution sociale, qu'à décrire la société future ( Instruction pour une prise d'arme). Comme, vu, plus haut, Blanqui est aussi et surtout un homme de terrain, participant, sans cesse, aux révoltes et aux différentes sociétés secrètes révolutionnaires. C'est surtout cela, qui lui donne une telle notoriété dans le coeur des ouvriers et des révoltés. Les
blanquistes
Durant son incarcération à Ste Pélagie (1861), Blanqui devient le maître à penser d'un groupe de jeunes révolutionnaires, qui forme le noyau d'une organisation clandestine, à la fois parti politique et armée secrète. Durant son exil en Belgique, Blanqui, vient en secret à Paris donner des instructions à ses partisans. Cette organisation qui sélectionnait très rigoureusement ses membres, compte entre 2000 et 3000 adhérents début 1870. Elle joue un rôle important dans les manifestations et les émeutes de cette époque. Thiers ne s'est pas trompé, quand à la veille de la Commune, sentant l'insurrection arriver, il fait arrêter Blanqui. Cela a contribué à désorganiser le mouvement et à entraîner la division de ses membres au sein du Conseil de la Commune. Thiers refusa toujours de céder à la demande des communards d'échanger tous les otages détenus par la Commune contre le seul Blanqui. Il déclara que rendre Blanqui à Paris équivalait à le renforcer d'un corps d'armée.
  « Tant qu'un Homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorge, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines » 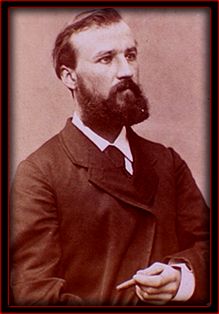
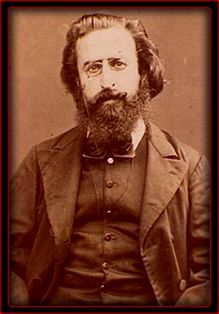 Militant Blanquiste, il gagne sa vie comme clerc d'avoué. Poursuivi plusieurs fois sous l'Empire pour délits politiques, il est traduit devant la Haute Cour de Blois en juillet-août 1870. Il est acquitté, faute de preuves. Après la proclamation de la république, en septembre 1870, Ferré s'engage sur de multiples fronts. Il collabore à La Patrie en danger, le journal de Blanqui. Actif sur Montmartre, il incorpore un de ses bataillons de la Garde nationale et devient membre du Comité de vigilance du quartier. Il officie également comme conférencier au club des Défenseurs de la république. Le 18 mars, il est partie prenante dans l'insurrection. Il monte avec Louise Michel et les membres du comité de vigilance de Montmartre sur la butte pour faire front à la reprise des canons par l'armée. Après la prise de l'Hotel de Ville, par la Garde Nationale, il est de ceux qui veulent aller sur Versailles pour renverser définitivement le gouvernement Thiers. Il est élu dans le XVIIIe arrondissement pour siéger au Conseil de la Commune, le 26 mars. Il y enchaîne différentes fonctions. Il est, d'abord chargé du compte-rendu des séances. Il est nommé à la Commission de Sûreté générale (affaires de police) le 29 mars. Il devientt ensuite substitut du procureur de la Commune, Raoul Rigault, le 1er mai, puis délégué à la Sûreté générale, le 13 mai. Il vote pour l'instauration du Comité de Salut public et se résigne le 24 mai à signer l'ordre d'exécution de 6 otages. Il en assumera toute la responsabilité lors de son jugement devant le conseil de guerre. Arrêté à la fin de la commune, la justice s'en prendra également à ses parents. Durant son incarcération il échangera des courriers avec Louise Michel, qui lui voue une grande passion amoureuse. Jugé le 07 août, il assume lui-même sa défense, déclarant au final : « Membre de la Commune, je suis entre les mains de ses vainqueurs. Ils veulent ma tête, qu'ils la prennent ! Jamais je ne sauverai ma vie par lâcheté. Libre j'ai vécu, j'entends mourir de même. Je n'ajoute plus qu'un mot : la fortune est capricieuse. Je confie à l'avenir le soin de ma mémoire et de ma vengeance. » Condamné à mort, le 02 septembre, il refuse de demander sa grâce.Lissagaray relatant son exécution, dit : « (...) Ferré vint le dernier, vêtu de noir, le binocle à l'oeil, le cigare aux lèvres. D'un pas ferme, il marcha au troisième poteau... Ferré jeta le bandeau, repoussa le prêtre qui venait à lui et, ajustant son binocle, il regarda bien en face les soldats. » |
||||||